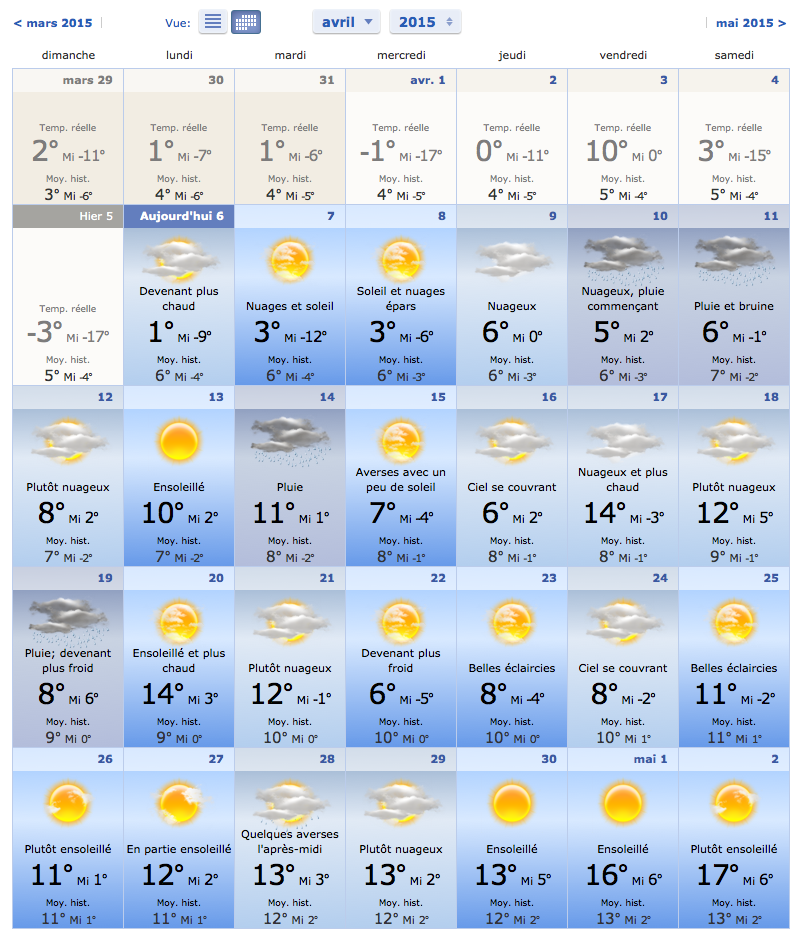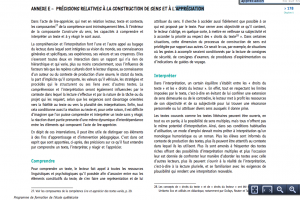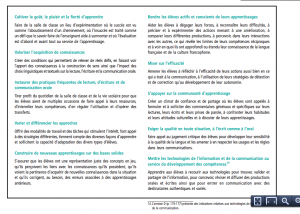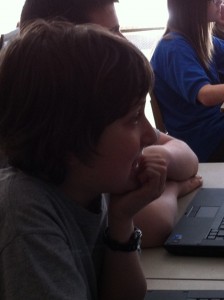« À quoi ça sert un prof? Ça sert à rendre pertinent ce qui ne serait que vrai.»
« À quoi ça sert un prof? Ça sert à rendre pertinent ce qui ne serait que vrai.»
Fernand Dumont
Ce billet est en réponse à l’exégèse écrite par Monsieur Loys Bonod dans le forum de son blogue à propos d’un de mes billets publiés à l’occasion d’une «amusante expérience qu’il a menée sur le Web.
Bonjour Monsieur Bonod,
Avant tout, permettez-moi de n’avoir pas rappelé dans le détail votre «expérience» puisqu’un hyperlien dans mon billet menait directement à la page où vous expliquiez vous-même très clairement ce que vous aviez fait. Il me paraissait superflu d’en rajouter.
Premièrement, je sais très bien ce qu’est un commentaire de texte. J’ai suivi un cursus scolaire en France. C’était il y a longtemps, mais je suppose que ça n’a pas dû évoluer beaucoup depuis que j’ai quitté le pays puisqu’il existe encore dans la même mouture l’examen oral du baccalauréat de français d’après ce que je lis là. Sauf qu’aujourd’hui c’est 25 ans plus tard la même épreuve. 25 ans… Quand même…!
Deuxièmement, il n’existe pas dans la sanction des études au Québec d’épreuve de lecture telle celle du commentaire de texte, une épreuve d’écriture permet d’obtenir le DES au terme de cinq années de secondaire. La lecture est évaluée par l’enseignant ainsi que la communication orale.
Troisièmement, je pense que le savoir a tout à voir avec n’importe quelle appréciation et interprétation de texte ou d’oeuvre, sinon sur quoi se baser pour commenter? Quels sont les critères qui nous permettent de justifier, d’argumenter, d’expliquer?
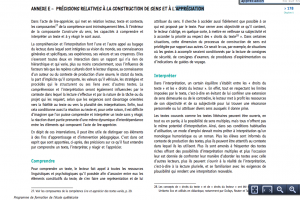
Les connaissances n’ont aucun rapport au savoir? Je me souviens de mes cours de lycée : la prof nous donnait SON analyse, SON commentaire composé, Sa lecture du texte et nous les apprenions par coeur pour le bac de français. À part exercer ma mémoire, je ne suis pas certaine que cet exercice ait développé ma capacité à analyser personnellement un texte. Alors oui, je conteste la pertinence de l’examen pour valider des compétences en lecture. Mais je ne vous tiens pas responsable du choix des épreuves qui sanctionnent les études en France! Ce qui m’afflige par contre à vous lire, c’est que vous avez l’air de justifier votre présence auprès de vos élèves seulement pour cette épreuve. Votre enseignement est destiné à leur faire passer un examen! Personnellement, je n’ai jamais vu mon rôle ainsi quand j’enseignais, en ZEP en France et ensuite au Québec.
P. 33 du PFEQ 2e cycle du secondaire
Poser un regard critique sur des textes courants et littéraires en appliquant des critères d’appréciation
Les élèves ont à observer les écrits sous plusieurs angles pour juger d’un propos ou pour commenter des façons d’écrire. Ils continuent à apprendre à tirer profit de leurs expériences, de leurs connaissances et de leurs repères culturels (œuvres lues, auteurs reconnus dans la communauté scientifique ou littéraire, stéréotypes, etc.) pour élaborer des critères et juger, par exemple, de l’intérêt ou du pouvoir d’évocation d’un passage, de l’originalité du traitement du sujet, de la solidité d’une hypothèse ou de la crédibilité d’un auteur. En confrontant leurs appréciations avec celles de leurs pairs et en prenant connaissance de commentaires de spécialistes ou de critiques, ils en arrivent à relativiser leurs jugements et à les formuler de façon nuancée. Cette famille de situations sert d’assise et de passerelle entre l’information et la littérature et, à l’aide de critères, elle permet d’apprécier aussi bien des textes courants que littéraires. Les critères que les élèves élaborent, d’abord avec le soutien de l’enseignant, puis avec de plus en plus d’autonomie, tiennent compte des indications fournies à l’égard de la qualité des textes et des œuvres dans le tableau du répertoire personnalisé.
De plus, je suis contre les corrigés en ligne, pas en ligne, en fait peu importe où ils se trouvent. Je suis pour qu’un élève fasse preuve de jugement critique en discriminant dans les sources à sa disposition celles qui seront les meilleures pour qu’il construise sa pensée et donne du sens à ses propos. Si j’avais à enseigner en France, je me servirais de ces corrigés en ligne comme exemples pour montrer à mes élèves comment tirer partie de leur répertoire personnel de connaissances et de repères culturels. Je leur apprendrais à les crititquer et à les commenter avec leur propre interprétation élaborée sur des critères précis. Je leur apprendrais l’autonomie et la confiance parce que ça en prend aussi de la confiance pour se prononcer sur un texte résistant voire hermétique quand ce n’est pas hors de leur portée comme le texte baroque que vous aviez soumis à vos élèves. Mais comment nos élèves peuvent-ils apprendre à le faire si personne ne le leur apprend?
PFEQ p. 1
L’enseignant doit les amener à établir des liens entre les apprentissages qu’ils font dans des situations diversifiées, à choisir les démarches les plus appropriées et à prendre l’habitude de réinvestir leurs acquis dans un large éventail de contextes scolaires et extrascolaires. Il doit également les amener à trouver un juste équilibre entre les ressources documentaires et littéraires de la bibliothèque, les rencontres avec des personnes qui exercent différentes fonctions et l’utilisation de l’ordinateur et d’Internet.
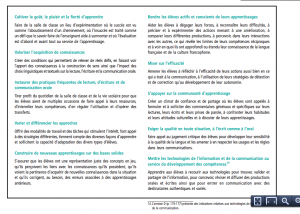
«Le mot n’est pas le sens», dit souvent Britt-Mari Barth. Ainsi, Web 2.0 ou web social renvoie à un concept bien précis, car il existe aussi le web 1.0 (web passif) et le web 3.0 (web sémantique) désormais. J’ose espérer que vous connaissez la différence sinon il y a Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 D’autre part, le fait d’utiliser l’expression ne confère aucune expertise technopédagogique! Cela vise simplement à préciser dans quel paradigme on se situe.
Ce qui doit s’imposer à l’école, c’est une révolution de la façon d’enseigner et d’apprendre. En cela, les outils du 2.0 apportent un soutien. Ils ne sont pas la finalité. Ils ne sont que des outils comme tant d’autres outils qui ne sont pas technologiques pour mieux développer des compétences en lecture, en écriture et en communication orale, pour acquérir des connaissances, construire sa vision du monde et son identité.
Vous trouvez mes propos diffamatoire parce que j’emploie des termes comme «manque d’éthique» ou encore «malhonnêteté intellectuelle». Cependant, ce sont ceux-là précisément qui conviennent à votre geste parce qu’il existait bien d’autres façons, et constructives, et engageantes pour faire prendre conscience du problème à vos élèves. Nous sommes tous confrontés au phénomène du copier/coller car l’information est très accessible. Cela induit que notre rôle d’enseignant doit tenir compte du contexte dans lequel nous enseignons. Le nier, c’est nier la société, le monde, le rapport au monde qui inclut le rapport au savoir, car l’école a pour mission d’y préparer nos jeunes. Au Québec, les enseignants possèdent un référentiel de compétences professionnelles. Je vous invite à prendre connaissance de la compétence 12 Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions.
D’autre part, j’ai relaté l’expérience de la prépa littéraire pour souligner l’absurdité de l’exercice qui m’était imposé à moi et aux autres. C’était un exemple, vous savez le procédé qu’on utilise comme étayage dans une lettre d’opinion. Je ne sais pas si vous êtes passé par le tordeur des classes préparatoires. Moi oui! Je me souviens des techniques de survie que nous (je dis bien NOUS, car je n’étais pas la seule à user de stratagèmes pour survivre au rythme et aux exigences. Personne ne dort en classes prépa sauf le matin dans les cours de philo pour rattraper quelques heures de la nuit passée à bûcher!) Pour preuve cette lettre écrite par une jeune normalienne récemment. J’aurais aimé que cet enseignant de latin au lieu de nous bombarder de textes à traduire sans aucun soutien nous modélise comment faire une bonne traduction, nous fasse comparer des traductions et nous montre pourquoi telle ou telle traduction était meilleure qu’une autre. Au bout du compte, j’aurais sûrement été capable de traduire par moi-même en y trouvant du plaisir, car j’aurais développé une confiance en mes capacités qui m’aurait détournée de l’envie de chercher ces aides dans les traductions retirées du circuit par ce prof si bienveillant et si déterminé à m’apprendre à penser… SEULE!
Les élèves n’ont pas davantage raison de tricher que vous avez le droit de les piéger. Éduquer, ce n’est pas ça. Je ne cautionne pas leur attitude, je la trouve simplement justifiée vu le contexte peu signifiant de la tâche pour eux. Il faudrait questionner la pertinence de maintenir l’examen tel qu’il est et vérifier ce qu’il valide pour vrai… À mon sens, certainement pas la capacité à lire.
Le web ne pousse personne à faire quoi que ce soit. Vos élèves trouvent des réponses en ligne parce que les questions qu’on leur pose sont «googlables»! Elles ne sollicitent ni leur créativité ni leur jugement critique. Posez une question dont la réponse demande recoupement d’informations, décryptage de l’inférence, analyse des énoncés, des objets, comparaison, etc. Bref, cela. Vous verrez la différence!
Dernière précision : j’ai travaillé à la validation des programmes de français et à la progression des apprentissages au Ministère de l’Éducation du Québec. J’ai ensuite travaillé à l’implantation et l’accompagnement dans le milieu de ces documents ministériels prescriptifs. Les exemples que je citais de nos programmes de français sont des exemples en contexte d’apprentissage et non d’évaluation.
Enfin, je me considère encore une élève, encore une apprenante active dans une communauté d’apprentissage qui est connectée par la technologie et qui s’alimente grâce à la technologie. Je n’ai jamais autant appris que depuis que je suis en réseau avec des centaines de professeurs à travers le monde et je travaille chaque jour à ce que ce réseau s’aggrandisse, se solidifie et joue un rôle dans la réussite des jeunes qui nous sont confiés.
Nathalie Couzon

 « C’est par les rêves que l’humanité forme malgré tout un bloc, une unité, et qui se comprend. »
Henri Michaux
« C’est par les rêves que l’humanité forme malgré tout un bloc, une unité, et qui se comprend. »
Henri Michaux